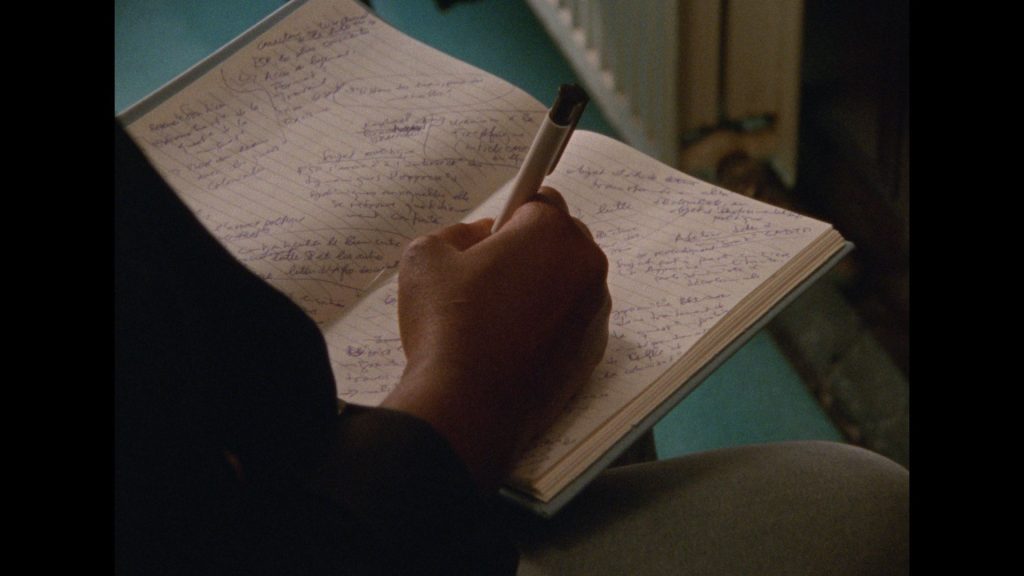En présence du réalisateur Robin Vanbesien
vendredi 13 juin 2025, 14:00-17:00
GC Ten Weyngaert
Entrée gratuite
Dans son film « Hold on to her », Robin Vanbesien met en scène une sorte de tribunal populaire, organisé par des citoyens avec ou sans papier. Ce forum analyse les violences policières et étatiques dans le cadre des contrôles aux frontières en Belgique.
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur Robin Vanbesien (discussion en anglais).
synopsis
Fille de Phrast et Shamden, sœur de Hama, Mawda Shawri avait deux ans en 2018 quand elle a été tuée d’une balle tirée par un policier belge lors d’un contrôle frontalier sur une autoroute.
Pendant l’été 2023, plus de 40 citoyens, avec et sans papier, se réunissent dans l’espace de rencontre de La Voix des sans-papiers à Bruxelles pour organiser une audience collective sur l’affaire Mawda.À cause de l’impunité de la police et de l’irresponsabilité de l’État, un fantôme semble hanter ce tribunal. Ces citoyens dénoncent les mensonges, les dénégations hypocrites et le manque flagrant de respect des droits humains dans les récits officiels. Ils éprouvent le besoin de reconstruire ensemble la vérité autour de cette affaire. Ils mènent une contre-enquête publique pour révéler les causes profondes du voyage mortel de Mawda et débattent des moyens d’y mettre fin. Progressivement, ce forum devient également un espace de deuil et de guérison collective.

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR ROBIN VANBESIEN
Pourquoi avez-vous choisi de centrer votre film sur l’affaire de Mawda Shawri, cette fillette de deux ans abattue par la police en 2018 lors d’une poursuite sur une autoroute en Belgique?
Depuis plusieurs années, je travaille sur des œuvres et des films qui racontent différentes formes de solidarité citoyenne qui sont de plus en plus réprimées dans le monde. J’ai décidé de me concentrer sur l’élan de solidarité qui a entouré l’affaire Mawda Shawri, un élan qui a atteint son apogée pendant le procès en 2021. La sociologue Rachida Brahim souligne que les violences policières et étatiques (mortelles) sont presque toujours suivies de déni et de manipulation de la part des forces de police et des autorités. On peut y voir comme un second meurtre symbolique, visant cette fois-ci la famille et les amis des victimes. Beaucoup d’autres victimes de violences policières en Belgique endurent ce même calvaire. En plus de l’âge de la victime (deux ans), une chose rend l’affaire Mawda frappante: les tentatives de la police et des enquêteurs de dissimuler la vérité étaient flagrantes, éhontées. Dans ce contexte, la recherche de contre-preuves par les militants semblait particulièrement nécessaire, car ce travail constitue la première étape vers le deuil et la guérison sociale.
Avec ce film, je veux montrer comment des citoyens ordinaires peuvent prendre ensemble des initiatives pour examiner d’un œil critique les activités de la police et de l’État. Ils peuvent ainsi mettre en lumière le non-respect scandaleux des droits humains et civils, causé par le racisme systémique et structurel qui paraît imprégner tous les niveaux de nos institutions publiques.
Dans le film, l’affaire est progressivement révélée par les voix de militants, d’avocats et de journalistes, alors qu’apparaissent à l’image des témoins silencieux. Une réunion se tient dans les locaux de La Voix des sans-papiers à Bruxelles, un réseau politique citoyen qui milite pour les droits de ces personnes. Dans quelle mesure votre film reconstruit-il les audiences organisées par les militants au cours des deux années précédant l’enquête judiciaire sur l’affaire Mawda? Et en quoi fonctionne-t-il comme un forum en quête de justice? Quel type de forum aviez-vous en tête?
L’affaire Mawda a suscité de nombreuses initiatives de solidarité dans les mois et les années qui ont suivi sa mort, le Comité Mawda Justice et Vérité et #Justice4Mawda étant les plus connus. Ces initiatives ont donné lieu à différentes formes d’assemblées publiques: des manifestations, des rencontres et des débats ouverts. Lorsque j’ai commencé à réfléchir au film en 2021, je me suis demandé comment je pourrais traduire l’imaginaire collectif de cette solidarité intersectionnelle. Ma première impulsion a été de m’assurer que les dialogues et les déclarations provenaient directement des militants, afin que ce qui était dit dans le film respecte l’intégrité de leurs voix, de leurs positions, de leurs perspectives. J’ai donc organisé de petites réunions et des entretiens individuels avec environ vingt membres de ces initiatives de solidarité, uniquement en audio. Les dialogues du film sont soit des fragments originaux de ces conversations, soit des textes basés sur elles. J’ai demandé à d’autresactivistes de participer à la restitution de certains de ces dialogues, afin que le réseau de solidarité sur lequel le film est basé soit représenté plus largement.
Ensuite, je voulais réunir ces différentes initiatives de solidarité dans un forum fictif, où les dialogues seraient joués devant la caméra par un petit groupe de militants. Il m’a semblé essentiel d’éviter une approche strictement documentaire. Nous avons au contraire adopté un point de vue artistique, ce qui nous a permis de réaliser une mise en scène photographique plus précise. Le forum, filmé au cours de l’été 2023, était composé de personnes qui avaient livré les témoignages originaux, complétées par celles qui avaient réenregistré certaines de ces déclarations. Nous avons prévu également un ensemble chargé d’apporter une touche poétique vocale au film, ainsi qu’un groupe d’auditeurs, constitués principalement d’activistes du réseau La Voix des sans-papiers.
Grâce à cette méthode de travail, je voulais démontrer que le cinéma peut fonctionner comme un espace de collaboration au profit du travail d’émancipation citoyenne: il s’agit d’explorer des formes de cocréation sociale (devant et derrière la caméra) afin d’aborder collectivement un traumatisme social.
Pendant qu’ils entendent des discours en français, en néerlandais, en kurde et en anglais — avec des citations tirées des récits fabriqués par les autorités et les médias belges, des analyses lucides d’avocats et de militants, et des voix qui expriment la colère et le chagrin — les spectateurs ont tout le temps d’observer un paysage d’autoroutes et leur environnement naturel. Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de revisiter la scène du crime avec tant d’attention aux détails? Pourquoi avez-vous utilisé différentes techniques cinématographiques? Que transmettent ces images au spectateur?
Dans le film, les dialogues se concentrent sur la contre-enquête. Il me semblait donc logique de revenir sur la scène du crime avec la caméra, afin de fournir des images qui appuient cette contre-enquête. Mais pour un cinéaste comme moi, il était crucial de me demander ce que représente ce lieu étrange qu’est une autoroute, au sens propre comme au sens figuré.
Un lieu que l’on traverse mais où l’on ne s’arrête jamais. Ma première intuition était de chercher avec le directeur de la photographie Diren Agbaba la meilleure manière de capturer avec la caméra ce que cela signifie d’être là. Nous avons observé les détails de la vie sur l’autoroute et de son environnement pour l’explorer visuellement comme un lieu vivant.
J’ai commencé par tourner en 8 mm analogique, ce qui correspondait à mon envie d’explorer l’image de l’autoroute à travers des fragments poétiques et oniriques. Nous avons rapidement compris le potentiel de cette approche cinématographique. C’est ainsi que Diren et moi nous sommes demandé comment nous pouvions appliquer cette approche à d’autres séquences et d’autres scènes que nous avions filmées en HD numérique. Notre démarche s’est concrétisée par des images fortement atmosphériques et sensorielles qui fournissent un contexte aux débats collectifs, sans vraiment illustrer le drame.Ces images de la scène du crime ont une connotation troublante, mais on peut aussi y déceler une issue, car à travers l’action de la caméra, je donne à ce lieu une présence, et donc un avenir.
Dans le film, les paroles alternent avec des chants expérimentaux, qui semblent être improvisés par certains témoins dans la salle. Qui chante ici, et comment ces chants contribuent-ils à votre forum?
Je voulais souligner que la quête de justice ne peut se faire uniquement par les mots, mais peut aussi passer par les expressions corporelles. Dès le début, j’ai senti que l’audience collective devait être accompagnée d’interventions poétiques vocales. En tant que praticien de la poésie vocale au sein du Post Film Collective (un collectif d’artistes avec et sans papiers), je me suis aperçu que cette discipline peut porter intensément et de manière percutante les sentiments collectifs. Pendant la préparation du film, j’ai créé un nouveau collectif temporaire d’artistes vocaux, composé de Marcus Bergner, Mahmoud Beshtawi, Mirra Markhaeva, Lázara Rosell Albear, Naomi van Kleef, et Khaled Zead.
Nous avons commencé par un atelier d’écoute au printemps 2022 à l’aire du Bois de Gard, le parking d’autoroute qui constitue un élément important de la scène de crime dans l’affaire Mawda. Ici, nous avons exploré ce que signifie l’écoute d’un lieu chargé de violences policières mortelles récentes, mais dont les traces visibles sont absentes, et où de plus le vacarme de l’autoroute couvre tous les autres sons. C’était un exercice particulier d’imagination collective, qui nous a donné une orientation forte et claire dans la création des sons vocaux pour le film.
L’un des fils conducteurs du film est le langage que nous employons pour parler de ces événements. Les protagonistes réfléchissent à l’utilisation de certains mots, comme «migrant», et décrivent les violences policières contre les migrants en des termes tranchants, par exemple «des gens qui chassent d’autres gens». Par moments, le film suggère que l’on peut avoir confiance dans la capacité des citoyens et des personnes concernées à ne pas cautionner l’affaire Mawda, tant au niveau politique qu’humain. Un film peut-il susciter ou renforcer cette capacité de résistance chez le spectateur, en contraste avec le sentiment omniprésent d’impuissance devant l’impunité des violences policières?
Dans mes premières conversations avec eux, les membres de ces initiatives de solidarité m’ont fait comprendre qu’il n’existe pas de cadre établi pour discuter des causes de cette violence systémique et racialisée. Cependant, pour ces militants, ce n’est pas une impasse, plutôt une invitation à l’imagination, à l’invention de nouvelles pratiques. Je souhaitais montrer dans ce film les manières exceptionnellement humaines, imaginatives et convaincantes dont le travail collectif de contre-enquête et de commémoration est mené dans ces cercles. On le voit bien dans la partie où les militants identifient le pouvoir du langage. L’abolition de la violence inhérente à la politique migratoire européenne actuellepeut commencer par des moyens très simples, très concrets: arrêter de répéter les mots qui déshumanisent les personnes en exil. Personnellement, j’ai cessé d’employer le terme de migrant car, pour moi, il est politique. C’est une façon simple de faire prendre conscience à nos concitoyens qu’une relation humaine avec ces exilés débute par le langage que nous utilisons, ce qui relève de nos propres responsabilités linguistiques et physiques. J’espère que ce film nous aidera à comprendre les réflexions, les pratiques et les sentiments qui sous-tendaient ces réunions. Ces méthodes peuvent nous apprendre à réunir les ressources nécessaires pour résister collectivement aux conséquences inhumaines de la politique migratoire européenne.

A propos du réalisateur
Robin Vanbesien est artiste, cinéaste, chercheur et professeur, et vit à Bruxelles. Il étudie les formes de connaissance individuelle et d’imagination collective qui sous-tendent les pratiques sociales et politiques, la solidarité et la lutte. Pour ce faire, il collabore souvent avec des mouvements citoyens émancipateurs.
Under These Words (Solidarity Athens 2016) a été présenté en première à transmediale 2019 et the wasp and the weather au Cinéma du Réel 2020. Son premier long métrage hold on to her a été présenté en première au Forum Expanded de la Berlinale 2024. En 2017, Vanbesien a publié le livre Solidarity Poiesis: I Will Come and Steal You (b_books Berlin). Il a été cofondateur du Post Film Collective (2020-2024), qui explore le cinéma comme espace de spéculation collective, d’imagination et de connexion. Il fait partie du groupe de travail transnational Cinema as Assembly (Institute for Radical Imagination). Depuis 2022, il coorganise les cercles d’étude Ciné Place-Making à Bruxelles. Robin Vanbesien a obtenu un doctorat en arts avec sa recherche Ciné Place-Making et enseigne dans le programme de master Contexte Socio-Politique à l’École des Arts Sint Lucas d’Anvers. Certaines de ses expositions, projections et autres événements ont eu lieu à: transmediale, HKW (Berlin), Cinéma du Réel (Paris), Contour 9 Biennale (Malines), Biennale d’Athènes, De Appel (Amsterdam), La Loge (Bruxelles), Sculpture International Rotterdam, WIELS (Bruxelles), Lumiar Cité (Lisbonne), St. Moritz Art Film Festival, Videograms (Vilnius), Arsenal Institut (Berlin), Objectif Exhibitions (Anvers), Extra City (Anvers), Kaaitheater (Bruxelles), Beursschouwburg (Bruxelles), Netwerk (Alost), FOMU (Anvers), Teatro Maria Matos (Lisbonne), Vooruit/Viernulvier (Gand), BUDA (Courtrai), Tënk, Fondation d’entreprise Ricard (Paris), Drop City (Newcastle Upon Tyne), Lemesos IDFF.
Informations pratiques
Date : Vendredi 13 juin 2025
Horaire : 14h00–17h00
Lieu : GC Ten Weyngaert (rue des Alliés 54, 1190 Forest)
L’entrée est gratuite, sur inscription uniquement (places limitées).
Si vous souhaitez assister à l’événement, merci de nous écrire à l’adresse suivante : soundimageculture@gmail.com